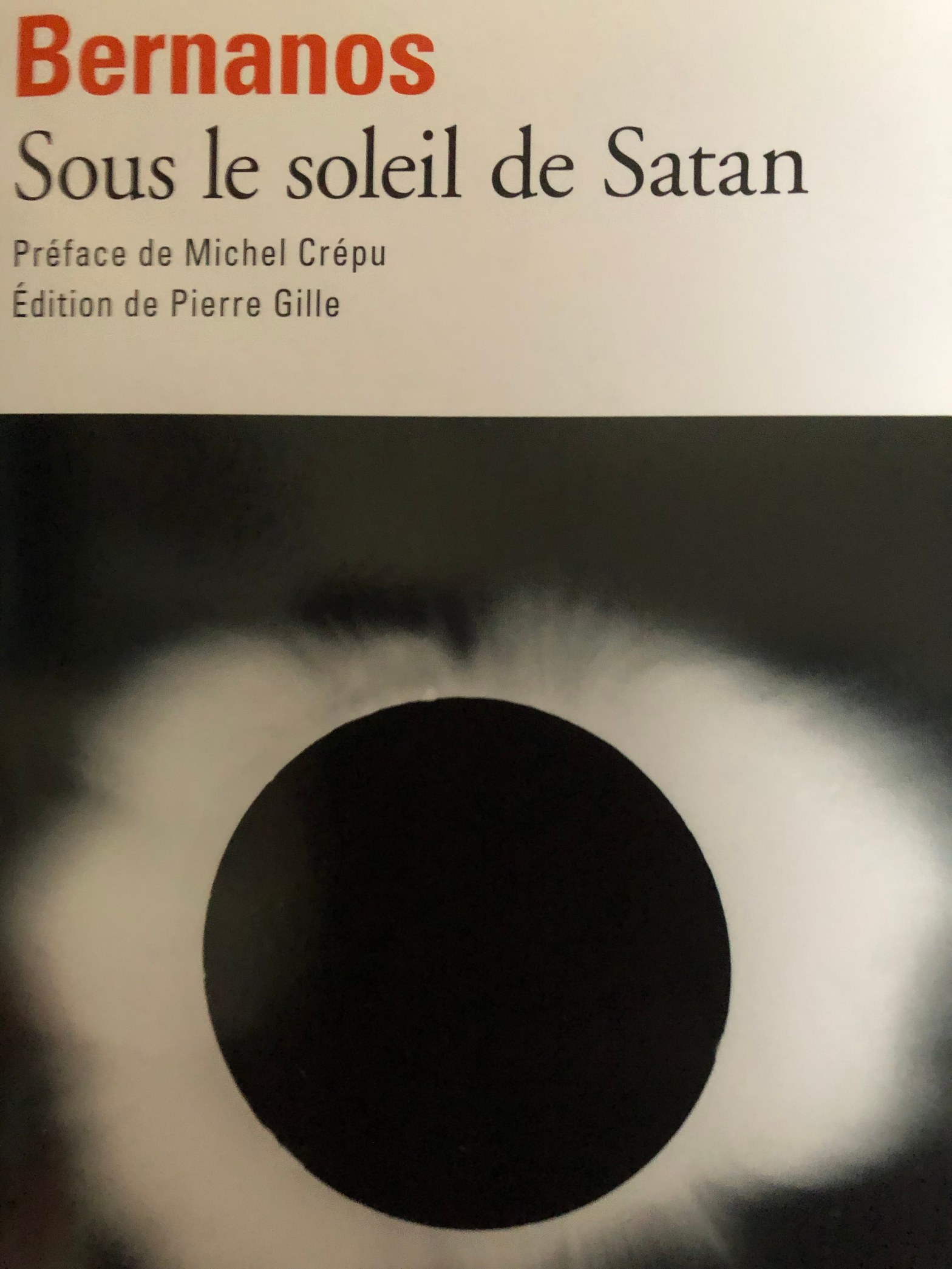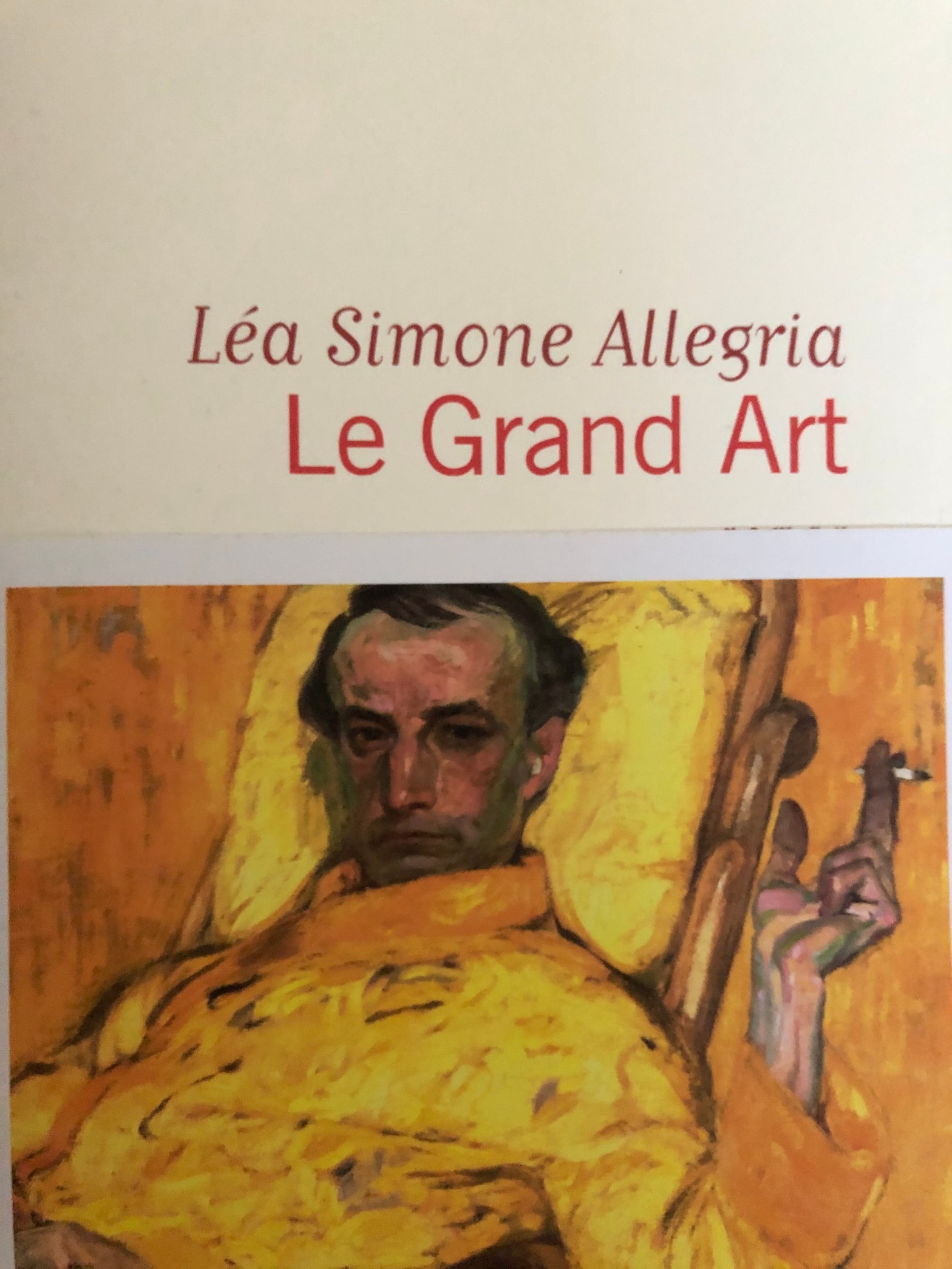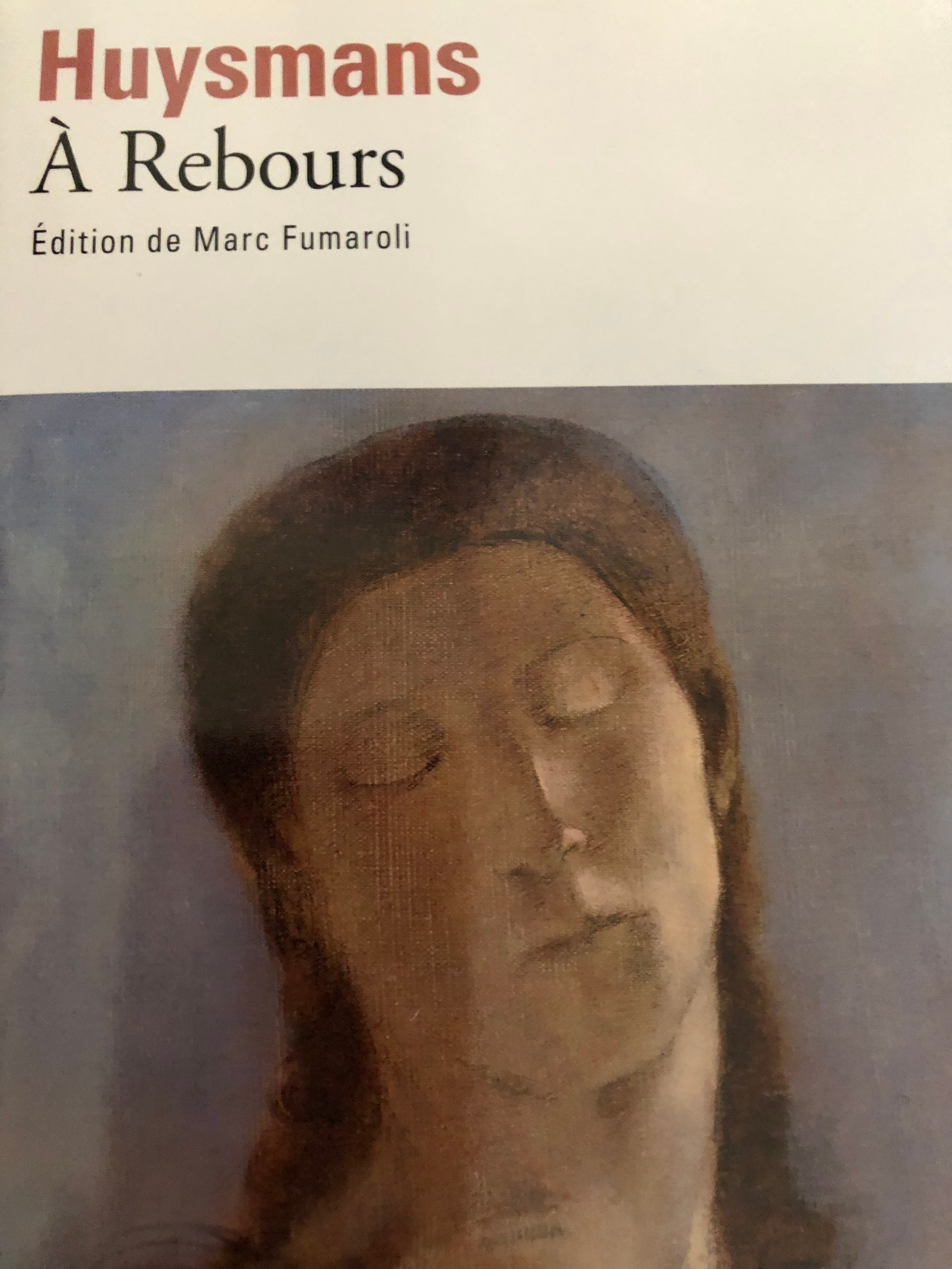« Je ne pense pas que le corps féminin soit encore sacré aujourd’hui »
C’est dans un petit restaurant de la Place du Marché Saint Honoré où elle a ses habitudes que Léa Simone Allegria a accepté de répondre à mes questions pour parler de ses deux premiers romans. Loin Du Corps publié en 2017 dans lequel elle relatait son expérience dans le mannequinat tout en questionnant le rapport des femmes à leur image corporelle dans une société où celle-ci est omniprésente. Et Le Grand Art publié en 2020, un roman quasi policier dans le monde du marché de l’art et des ventes aux enchères. Un entretien passionnant avec une grande écrivaine en devenir.
A la lecture de votre premier roman on est frappé par votre style qui est très direct, il semble inspiré du cinéma de la Nouvelle Vague, les dialogues ressemblent un peu à ceux des films de Godard ou de Truffaut, cela a-t-il été une source d’inspiration pour vous ?
Léa Simone Allegria : J’adore les films de la Nouvelle Vague mais non, même si on absorbe beaucoup de choses à son insu donc peut-être, mais la question des influences n’est pas facile car ce n’est jamais vraiment réfléchi, à part pour la peinture qui est clairement inscrite dans mon ADN ou même énoncée dans le texte. Mais sinon il y a des auteurs que j’adore et des livres qui sont mes livres de chevet mais l’influence est plutôt inconsciente. Mais parfois cela peut être plus concret comme en ce moment où je suis en train de réfléchir à un troisième roman, j’ai déjà des idées et là j’ai relu Tiens Ferme Ta Couronne de Yannick Haenel parce que je voulais voir comment il avait choisi cette narration à la première personne et parlé d’un écrivain (Herman Melville), et il y avait tout ce style un peu apocalyptique et un peu fou que je voulais retrouver. Donc là peut-être qu’on pourrait parler d’influence parce que sciemment je suis allé chercher ce livre que j’avais déjà lu en me disant « Tiens j’ai envie de le relire pour me donner une inspiration ».
La psychanalyse tient une place prépondérante dans votre premier roman, cela a-t-il été un cheminement important pour vous ?
L.S.A. : Honnêtement la psychanalyse je n’y comprend pas grand-chose, j’aurais bien aimé parce que je trouve ça effectivement passionnant mais Loin Du Corps c’était très tiré de mon expérience personnelle et donc c’était pour essayer de me comprendre moi-même, de me sauver moi-même car j’ai eu un moment difficile dans ma vie. J’avais essayé de voir des psys justement, quatre ou cinq, mais je n’ai jamais réussi à trouver quelqu’un qui trouve réponses à mes interrogations. Mais dans le roman, en essayant de me comprendre, je décortique des choses pour trouver ce qui se passe en moi.
Il y avait ce personnage du psychanalyste dans Loin Du Corps qui était assez déroutant…
L.S.A. : C’est un peu ce que je ressentais oui. J’attendais avec une impatience folle le jour où j’allais retrouver le psy car j’avais l’impression qu’il allait tout d’un coup me sauver, et puis à chaque fois il ne se passait rien et c’était encore plus déroutant… Ce n’était pas difficile, c’est juste qu’il avait l’air de s’ennuyer un petit peu comme le personnage dans le roman. J’en attendais trop et en réalité les psys ça ne peut pas vous sauver comme ça… Quand on est si mal que ça je pense que c’est peut-être une solution mais ça ne peut pas faire de miracles.
Les références à l’histoire de l’art étaient déjà très présentes dans Loin Du Corps et c’est quelque chose qui vous a construit et que vous avez souhaité approfondir dans Le Grand Art ?
L.S.A. : Oui j’ai fait l’École du Louvre après avoir fait une prépa littéraire et un Master de Lettres Modernes à la Sorbonne. J’ai fait aussi des arts appliqués aux Ateliers de Sèvres et l’École du Louvre c’est venu au même moment mais c’était un peu par hasard parce que je ne savais pas quoi faire. J’aimais un peu tout, j’aimais la littérature mais un Master de Lettres après la prépa ce n’était pas suffisant parce que le rythme de la prépa est assez effréné et donc je m’ennuyais un peu à la Sorbonne. Le rythme de la prépa me plaisait bien mais les concours moins donc je ne les ai pas passés. Mais c’était surtout pour apprendre, j’écrivais plein de trucs sur des carnets, des dates, j’aimais bien accumuler des connaissances et donc je suis tombé sur l’École du Louvre comme ça. Et en fait j’ai adoré cette école, vraiment, parce que c’était passionnant, j’allais tous les jours au Louvre, j’avais la carte qui me le permettait, je l’ai toujours d’ailleurs mais maintenant c’est une carte professionnelle. Et dans cette école on se posait devant une œuvre et on devait la décrire en dix minutes chrono, c’était comme ça au quotidien et donc toutes ces œuvres sont restées dans mon imaginaire car je les ai tellement étudiées et décrites pendant quatre ans que maintenant elles font partie de moi intégralement. Et la façon de regarder du Louvre je l’ai toujours quand je me balade dans les rues, devant les statues, tout de suite dans ma tête c’est « description », « datation », la méthodologie Louvre complétement ! C’est une façon de voir les choses qui fait que ça m’aide beaucoup pour parler de ce que je vivais dans le mannequinat, et dans Le Grand Art pour parler du dessous des œuvres, des tableaux, c’est une façon de voir les choses qui m’est restée.
Pensez-vous comme c’était le cas pour les sculpteurs de statues grecques de l’Antiquité que la beauté repose sur des lois mathématiques ? C’est une question que l’on retrouve dans le monde de la mode également.
L.S.A : Justement non. J’espère que j’ai montré que je n’y croyais pas du tout, dans le sens où chaque personne est différente et a des proportions qui lui sont propres. Je comprends les proportions idéales en mode, quand on vous demande de faire un 36 de tour de taille, c’est pour une question de patronage mais cela n’a rien à voir avec la beauté, pas du tout. C’est une question pratique dans la mode, que je comprends, j’ai mis du temps à la comprendre car je la trouvais injuste, mais quand on fait ce métier-là, c’est justement pour ça car on a des proportions dites « idéales ». Car on crée les modèles sur nous, par exemple en ce moment je travaille pour Laure de Sagazan qui est une créatrice de robes de mariées, elle demande de faire un 38, moi je fais plutôt un 36 et je comprends que cela crée des problèmes de patronage. Mais les proportions idéales, le « canon grec » je le comprends pour une statue, je comprends pourquoi cela a été institué, mais si on pense aux statues d’Akhenaton qui sont très menues du haut et larges du bas, c’est magnifique aussi ! Les définitions de la beauté sont pour moi infinies.
Nietzche disait d’ailleurs dans Vérité et Mensonge au Sens Extra Moral qu’autant il n’y a pas de vérité absolue, que le mensonge n’existe pas non plus, il n’existe que quand une personne trompée estime subir un préjudice, mais qu’il n’y a pas de beauté non plus dans l’absolu, il n’y a de beauté que pour la personne qui a définit le type de beauté qui lui plaisait. Mais dans la nature indépendamment de notre regard, il n’y a pas de beauté…
L.S.A. : Je suis d’accord avec ça, complètement, même les beautés naturelles ne sont pas mathématiques. Elles ont été forgées par le hasard, par l’évolution, et plus c’est cabossé plus j’aime en général ! Les physiques d’hommes un peu cabossés correspondent à mon idéal masculin, je préfère aussi les gâteaux un peu cassés, un peu mal faits !
Dans Loin Du Corps vous donnez aussi la réponse à la question de savoir pourquoi les statues grecques avaient de si petits sexes…
L.S.A : Oui c’est une question que l’on se pose quand on voit ces statues, c’est un critère de beauté qui a été perdu dans le temps. Aujourd’hui on privilégie plutôt les gros pénis, pas uniquement dans les films pornographiques mais dans la vie en général. C’est une chose dont on parle souvent, c’est peut-être un mythe aussi sur les préférences des femmes, un lieu commun de nos jours. Mais pour les statues grecques c’est parce que les grecs privilégiaient le siège de la pensée, la posture intellectuelle.
Finalement le titre Loin Du Corps symbolise-t-il plus l’éloignement de l’héroïne d’avec son propre corps ou la dépossession qu’en fait la société par sa normativité ?
L.S.A. : Je pense que justement elle s’éloigne de son corps. Le mot « corps » peut aussi être remplacé par « image ». Elle s’éloigne de sa propre image par ce qu’elle en fait elle-même. Elle rentre dans ce milieu là et puis on la dépossède de son image, de son corps qui devient un objet, un outil de travail, et c’est difficile de garder une distance vis-à-vis du monde du mannequinat. C’est ce que j’ai essayé de montrer, c’est difficile de ne pas se laisser engloutir par tout ce monde là et par exemple quand on nous dit qu’il faut qu’on fasse un 92 de tour de hanches etc. Quand on est jeune comme ça et qu’on fait l’apprentissage de son propre corps c’est très difficile de mettre une distance et de se dire « c’est parce qu’ils en ont besoin dans ce milieu-là, pour une norme et une question de patronage ». On se dit plutôt « Ah merde, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, il faudrait que je sois comme ça parce que c’est ça la norme ». En oubliant que la norme elle est complètement autre dans la vraie vie, on oublie ça parce qu’on devient un objet et qu’on veut coller complètement à l’image à laquelle on nous demande de correspondre. Donc à ce moment-là on s’éloigne de son propre corps.
A votre avis cela vient d’où ? Vous avez parlé de patronage, apparemment il y a beaucoup de critères assez stricts dans la mode…
L.S.A. : Alors il y a beaucoup de critères dans la mode, ceux des mannequins « cabines » ce que j’ai fait pendant longtemps, c’est-à-dire le patronage, mais il y a aussi les mannequins « runway » qui font des défilés, qui sont beaucoup plus maigres et beaucoup plus grandes, donc là c’est très squelettique. Il y a aussi les mannequins photo, parfois on peut faire un peu de tout mais en général ce n’est pas le cas.
Et ces critères sont imposés par les créateurs ?
L.S.A : C’est imposé par les créateurs, par les magazines, on dit que ça change mais pas assez vite. Mais on voit plus de diversité, en tout cas dans les campagnes de pub, dans les éditoriaux. Il y a de plus en plus de corps différents qui sont proposés dons oui ça change un petit peu mais la norme elle reste quand même celle de la fille qui a 18 ans, filiforme et à la limite de l’anorexie.
Ce qui d’ailleurs n’est pas perçu par les hommes comme un critère de beauté…
L.S.A. : Non d’ailleurs pour moi non plus ce n’est pas un critère de beauté. C’est beau parce que ça donne un air très juvénile, très enfantin, très fragile et c’est quand même joli. Mais quand on les voit à poil, pour les avoir vues longtemps, parce que je me changeais au milieu d’elles, il y a quand même beaucoup d’os partout, qu’on gomme sur Photoshop, c’est assez effrayant…
Diriez-vous que l’héroïne de votre premier roman est davantage une Venus moderne maitresse de son propre corps et qui en tire profit plutôt qu’un objet sexuel ?
L.S.A. : Je pense que cela dépend à quel moment du roman. Je pense que Adrienne arrive à un moment où elle peut reprendre le dessus et où elle s’éloigne de tout ça et elle se dit que c’est possible de faire autrement. Elle retrouve un peu sa liberté, reprend confiance, reprend la maîtrise de sa vie, elle n’est plus dans cette dépression dans laquelle on la trouve au début du roman et on sent qu’elle peut s’envoler et faire quelque chose. Et puis ça retombe par une conjoncture de plusieurs facteurs, mais à la fin quand elle dit qu’elle assiste au mariage de sa propre image, c’est une façon de dire qu’elle se laisse complètement dissoudre ou absorber par sa propre image et donc c’est l’image qui gagne, qui l’emporte sur ce qu’elle aurait pu être, sur son propre désir et sur sa propre volonté et sur ce qu’elle aurait pu devenir. A la fin c’est le corps qui gagne.
Selon vous quel est la part du sacré et du profane dans les représentations et les images des corps féminins de nos jours ?
L.S.A. : Je ne pense pas que le corps féminin soit encore sacré aujourd’hui car quand on voit le nombre de corps qui sont exhibés sur les réseaux sociaux ou quand on ouvre un magazine ou partout dans la rue sur des publicités, le corps féminin est quand même très montré. Il peut devenir sacré grâce à l’art encore aujourd’hui, oui je pense. Ce qui me vient en tête c’est l’image de Beyonce avec ses jumeaux dans les bras et qui se présente comme une Madone et bien je le trouve magnifique ce corps et je trouve que cette image est très belle. Cela montre sa féminité, sa puissance, la maternité et là je trouve que oui son corps est sacré. Après au quotidien, ce qu’on fait des corps féminins, quand je voie le nombre de jeunes femmes qui s’exhibent sur les réseaux sociaux, on peut se poser la question. Mais aussi pour le corps des hommes, peut-il être encore sacré ? A travers l’art oui mais pas exhibé comme ça pour une publicité ou sur internet comme c’est le cas sur Instagram. Dans ce cas il l’est beaucoup moins.
Dans Loin du Corps l’épisode du chercheur en histoire de l’art qui se prend pour Édouard Manet est-il une métaphore de la folie du monde des arts, de celui de la mode ou de notre époque ?
L.S.A. : Je ne crois pas qu’il y ait une folie de notre époque, il y en a une bien sûr mais je pense qu’à toutes les époques il y a eu des folies. Mais ce n’était pas pour parler d’une folie particulière de la mode ou de l’art, c’était d’abord pour parler de l’Olympia de Manet, une manière d’en parler qui m’amusait et puis on rencontre souvent des personnes qui sont complètement exubérantes comme ça, qui restent bloquées sur des choses, qui ont des obsessions, pas forcément dans un milieu particulier, mais je souhaitais parler de quelqu’un qui aurait eu une obsession au point de basculer dans la folie.
Pensez-vous comme votre héroïne Adrienne qu’il soit absurde que Manet se soit rendu la vie impossible parce qu’il avait honte d’une vie hors de la norme ? (Il avait eu adolescent un enfant avec sa jeune prof de piano). Est-il encore aussi difficile aujourd’hui de faire fi des conventions sociales ?
L.S.A. : Adrienne le juge à ce moment là mais c’est compliqué de juger car nous ne sommes plus à la même époque et on ne peut pas savoir exactement quelles auraient été les conséquences de la vie qu’il menait. Mais dans le cas d’Édouard Manet il y a la question de la vie de cet enfant qui est en jeu et c’est cela qui m’a fait de la peine. Il ne savait pas vraiment si Manet était son père ou son oncle… Mais la question des conventions sociales ou du regard des autres continuent à être aussi importants aujourd’hui. Dans un certain sens oui mais heureusement beaucoup moins qu’à l’époque de Manet, beaucoup moins qu’au XIXe siècle, les conventions sociales sont différentes, elles sont toujours présentes forcément mais on est quand même beaucoup plus libre de faire ce qu’on veut et de vivre comme on veut et on est de moins en moins jugé, surtout en ce qui concerne nos choix matrimoniaux, le mariage ce n’est plus du tout une question.
Vous montrez dans votre second roman Le Grand Art comment le marché des œuvres d’art a été lui aussi bouleversé par l’arrivée d’Internet, des enchères en ligne et des réseaux sociaux où notamment Instagram a pris une place prépondérante…
L.S.A. : Oui cela a complètement changé le visage du marché de l’art, depuis ce que l’on a appelé la « révolution numérique » ce n’est plus le même métier. Cela reste des marchands qui vendent de l’art mais la manière de le vendre est totalement différente.
Et certains sont donc complètement « has been » comme le personnage principal du roman qui n’a pas pris ce tournant…
L.S.A. : Je n’en ai pas rencontré personnellement mais je l’ai imaginé. Je l’ai même vu dans d’autres milieux, des gens qui n’ont pas pris ce tournant du numérique. Ce sont des gens d’une certaine génération mais parce que contrairement à nous ils n’ont pas grandi avec ça. On a été une génération charnière qui a connu le monde sans Internet et c’est arrivé alors qu’on était jeune donc on a pu s’adapter. Mais pour nos parents ce n’était pas du tout le cas et pour des gens qui sont un peu plus âgés que nos parents encore moins. Je trouve ça super intéressant car on est dans une révolution complète des façons de communiquer, de vivre et d’être et donc oui j’ai voulu en parler à travers l’art.
La découverte par le personnage principal d’un tableau méconnu de la Renaissance lui procure un véritable vertige voire une illumination. Pensez-vous qu’une œuvre d’art puisse à ce point nous bouleverser intérieurement ?
L.S.A. : Bien sûr, cela s’appelle le « syndrome de Stendhal ». Moi cela m’est déjà arrivé d’être complètement transportée par un tableau, d’être complètement sens dessus dessous à cause d’une œuvre, de la regarder jusqu’à en perdre peut-être pas l’équilibre parce que ce serait un peu extrême mais jusqu’à se perdre complètement à l’intérieur de l’œuvre oui cela m’est déjà arrivé.
Et cela n’est pas forcément lié au caractère religieux de l’œuvre comme dans le roman, une Vierge à l’Enfant…
L.S.A. : Non cela n’a rien à voir avec la religion, il se trouve que c’est une Madone à l’Enfant mais cela aurait pu être des Tournesols de Van Gogh… Mais dans le cas de Paul Vivienne, il tombe dans les pommes à ce moment là car cela résonne avec quelque chose en lui, de son histoire.
Le fait que ce tableau soit daté dans le roman probablement de l’époque de la Grande Peste, rétrospectivement c’est assez amusant car votre roman est paru juste au début de la pandémie de Covid-19, vous y voyez comme une sorte de synchronicité ?
L.S.A. : En tout cas je ne pouvais pas le prévoir car j’ai écrit le roman deux ans avant donc c’est un pur hasard…
Pensez-vous qu’il soit encore véritablement possible de découvrir un tel tableau, de la première moitié du XVe siècle, d’autant plus s’il est apparemment parmi les premiers à comporter les lois mathématiques de la perspective ?
L.S.A. : Ah mais cela arrive tout le temps ! Et on peut même découvrir des tableaux de maîtres aujourd’hui. C’est ce qui est arrivé avec le Caravage à Toulouse dernièrement. Découvrir des tableaux dans des chapelles, des œuvres perdues, cela arrive tout le temps, c’est cela qui est fascinant.
Mais en découvrir un qui serait d’un auteur inconnu, mystérieux ou maudit comme c’est le cas dans votre roman ?
L.S.A. : D’un auteur inconnu oui cela arrive tout le temps. C’est tout le problème de trouver l’attribution ensuite. Maudit ou mystérieux ça c’est le domaine de la littérature ! C’est ce qu’on en fait a posteriori, il est maudit parce que j’ai dit qu’il était maudit mais si cela se trouve il ne l’était pas !
Vous avez rédigé la quête du nom de l’artiste du retable comme une véritable enquête policière, notamment sur les lieux à Florence…
L.S.A. : Ce n’était pas intentionnel, je n’y ai pas réfléchi vraiment mais je me suis prise au jeu de ce que j’écrivais et je me suis amusée à faire mon enquête. Et je l’ai vraiment faite, c’est-à-dire que je suis allé à Florence, à Santo Spirito, j’ai découvert qu’il y avait eu un incendie et que les archives étaient introuvables. Je me suis rendue à la bibliothèque florentine et j’ai découvert qu’il y avait des manuscrits d’apothicaires, tout cela est réel, j’ai inventé beaucoup de choses mais cela est réel en tout cas sur les éléments historiques. Et quand je parle de ce peintre Masino qui aurait vécu à Florence et que je raconte qu’il y avait un barbier au coin de la rue, il y en avait vraiment un, tout cela je l’ai recherché et donc cela donne un style un peu polar car c’est vraiment le fruit de mes recherches, j’ai vraiment mené mon enquête.
Dans les lettres d’apothicaires vous n’avez pas vraiment trouvé de Masino ?
L.S.A. : Non il n’y en avait pas ! (Rires).
Pensez-vous comme votre personnage principal que l’authenticité d’une œuvre d’art dépend de la réputation de l’expert ?
L.S.A. : Oui j’ai participé à des affaires de recherches d’authenticités et justement j’étais très surprise de voir que tout dépendait de l’expert. A chaque fois. Et j’ai rencontré un expert de Rembrandt à Amsterdam qui est le deuxième expert mondial de réputation. Mais le premier expert mondial ayant plus de 80 ans, il me disait qu’il y avait une œuvre que cet expert ne reconnaissait pas comme un Rembrandt alors que pour lui c’en était un. Donc après sa probable future disparition, le deuxième expert va devenir le premier expert mondial et donc ce tableau va devenir un Rembrandt. C’est un peu arbitraire.
Cela fausse un peu la valeur de l’œuvre ?
L.S.A. : A 100% ! J’ai des amis à New York qui ont un Soutine chez eux. Ils l’ont fait expertiser. Les experts de Soutine qui ont plus de 80 ans disent que ce n’est pas un Soutine. Mais après avoir fait des recherches avec eux, il n’y a aucun doute que cette œuvre faisait partie de la collection de Helena Rubinstein qui a elle-même fréquenté les ateliers de Soutine et de Modigliani. Donc c’est assez clair que c’est un Soutine. Mais les experts disent que Helena Rubinstein a certes acheté cette œuvre mais qu’elle aurait acheté un faux. A l’époque même de Soutine ! Moi j’en doute. Je pense que c’est un Soutine mais qui suis-je pour le dire… Pour l’instant ce n’en est pas un mais peut-être qu’un jour cela le deviendra avec de nouveaux experts. Donc tout dépend des experts et donc c’est ce que j’ai essayé de montrer dans Le Grand Art.
D’ailleurs, sans rien révéler du dénouement du roman, c’est la ténacité de la jeune experte Marianne Javert qui finit par l’emporter face à ceux qu’elle considère comme des sceptiques… Mais qui n’avaient peut-être pas entièrement tort…
L.S.A : Oui cela m’a amusé de brouiller un peu les pistes ! (Rires).
Vous avez aussi fait un lien dans votre roman entre le monde de l’art rattrapé par celui de la mode et de la pop culture, notamment avec le rôle joué par Madonna et Jean-Paul Gaultier dans un Met Gala dont le thème était l’imaginaire catholique…
L.S.A. : C’était un thème qui est tombé pile poil au moment où je l’écrivais et je me suis dit Masino va y aller ! Il y a eu des expositions, des déguisements autour de ce thème et j’ai imaginé un Masino foulant le tapis rouge !
Vous montrez aussi que dans ces ventes aux enchères les grandes fortunes sont intéressées par une œuvre davantage en fonction des autres acquéreurs potentiels plutôt que par l’œuvre elle-même…
L.S.A. : Oui il y a tout un jeu de concurrence entre ces grandes fortunes, c’est pourquoi c’est plus ou moins secret, on ne dit pas qui est intéressé par telle ou telle œuvre, et ces grandes fortunes n’acquièrent pas une œuvre pour leur plaisir mais parce que ce sont des investissements. Pour la plupart des acquisitions de haute voltige, les acquéreurs ne verront jamais l’œuvre en vrai et elle partira directement dans un coffre en sous douane ou dans une banque et c’est juste un placement. Une valeur monétaire.
C’est lié à l’exonération fiscale ?
L.S.A. : Oui c’est aussi grâce à ça que c’est très lucratif.
On devine également à travers cette vente que se déroule en réalité un combat presque géopolitique entre l’Italie et la France pour savoir qui récupérera et au final exposera cette œuvre…
L.S.A. : Oui il y a toujours des courses pour retenir des œuvres d’art majeures, les œuvres d’importance. Le musée du Louvre préempte parfois mais je ne sais pas si cela arrive si souvent mais je sais que cela arrive.
Dans votre récit on se rend compte qu’il était inévitable que commence à circuler de fausses œuvres attribuées à ce maître méconnu ?
L.S.A. : Oui si on découvre que la signature de tel maître méconnu rapporte tout d’un coup des millions, on ne va pas priver de l’imiter ! Il y a beaucoup de faussaires, quand j’ai fait mes recherches j’ai parlé avec des restaurateurs de tableaux, notamment au Louvre et ils m’ont dit que le problème des faussaires qui peignent à la manière du XVe siècle cela arrive tout le temps aujourd’hui. Ils ont tout un tas de systèmes pour se prémunir contre ça. Mais ce problème est très présent.
Sans révéler le dénouement du roman, pensez-vous qu’il soit possible de créer véritablement un mythe tel que celui de ce « Masino », un mythe qui doit tout à la relation tourmentée entretenue entre votre personnage principal et l’experte Marianne Javert ?
L.S.A. : C’est la question que je pose, je ne sais pas si cela existe mais ce livre c’est pour dire que cela aurait pu exister, dire que Caravage c’était un peintre maudit qui a tué quelqu’un et a été damné, qu’il peignait extrêmement vite sans dessins préparatoires, cela est peut-être une invention du XXe siècle.
On pourrait d’ailleurs imaginer que sur le marché de l’art une œuvre de la Renaissance vienne supplanter un Jeff Koons ou un Damian Hearst ?
L.S.A. : Oui d’ailleurs l’œuvre la plus chère du monde c’est un Léonard De Vinci, le Salvator Mundi, et non une œuvre contemporaine et de très loin. Mais on n’en sait rien en réalité si c’est un Léonard… Mais elle lui est attribuée. D’où vient-elle ? Quelle est son histoire ? On n’en sait rien du tout et je considère qu’on a créé un peu un mythe autour de cette œuvre.
La morale de cette histoire n’est-elle pas que la préservation d’un mythe fut-il nouveau doit être supérieure à toute autre considération ou le destin du héros n’est-il dû qu’à une succession de péripéties et de choix personnels ?
L.S.A. : Un peu oui, comme dans Qui Tua Liberty Valence, préserver le mythe, préserver l’histoire, c’est de dire que peu importe qui a peint l’œuvre en question, son authenticité, pourvu que cela nous fasse rêver et qu’on l’aime telle qu’elle est même si c’est un mensonge. Peut-être pas à tout prix, mais ce qui est beau quand on se balade dans un musée ou dans l’histoire de l’art c’est ce mystère. Car savoir si c’est vrai ou faux on ne le saura jamais. Mais pour Paul Vivienne c’est assez clair dés le début qu’il va vivre son chant du cygne. C’est son dernier coup il le sait. Il ne va pas revenir et retrouver une carrière et tout recommencer. Que pourrait-il faire après ? Il n’y a pas trop de choix pour lui. Je ne trouve pas cela si triste qu’il tire sa révérence en pleine heure de gloire plutôt que de décrépir… Il échappe à la vieillesse et à la décrépitude. Il aurait voulu être encore dans le game et dans l’action et il l’a obtenu ! Et il est beaucoup mieux à la fin du roman qu’au début où il était dans l’inaction, complètement dépassé, c’est cela qui était terrible… Vouloir perdurer dans le métier alors que ce métier a disparu avant soi-même, c’est cela le pire…
Mais il aura vécu quelque chose d’intense et sera revenu à sa place et finira par partir sur un moment de gloire et c’est ça qui est beau !
Pour finir au sujet de votre futur troisième roman, pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Allez-vous explorer un autre univers ?
L.S.A. : Je pense que ce sera beaucoup plus intime, un peu comme dans Loin Du Corps, je reviendrai un peu sur ce genre de choses. Sans tomber dans l’autofiction, car ce sera quand même une vraie fiction avec de vrais personnages qui auront leur propre identité mais je reviendrai sur un thème qui me sera plus proche. A la croisée de Loin Du Corps et de Le Grand Art, ce sera quelque chose de plus personnel mais avec une vraie histoire quand même.
Propos recueillis par Nabil Khaled.
© Tous droits réservés.
Léa Simone Allegria, Loin Du Corps, Le Seuil, 299 pages, 18 € ; Le Grand Art, Flammarion, 351 pages, 20 €.